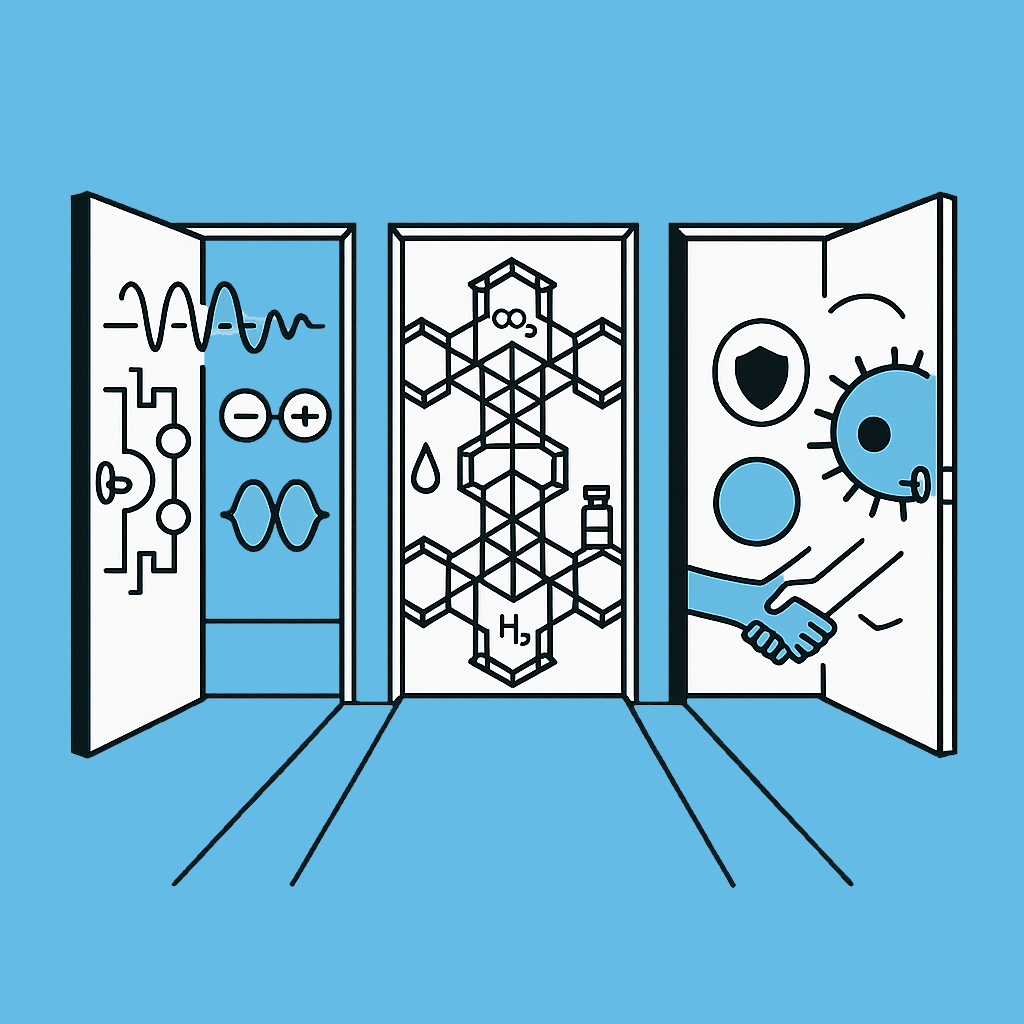Un badge qui s’allume. Un écran qui clignote. Une conversation Slack plus pour exister que pour avancer. Ce scénario, beaucoup d’entre nous le vivent chaque semaine. Et si la vraie révolution du travail n’était pas technologique, mais culturelle ?
Le paradoxe du siècle
Dans les années 1930, l’économiste John Maynard Keynes imaginait que nos arrière-petits-enfants ne travailleraient que 15 heures par semaine. Il voyait dans la productivité le moyen d’acheter du temps libre. Et il avait raison sur les gains : le PIB réel par habitant américain est aujourd’hui cinq fois supérieur à celui de 1931. Mais nous travaillons toujours environ 40 heures hebdomadaires. La promesse d’une société du loisir ne s’est jamais concrétisée.
Pourquoi ? Parce que deux forces se sont affrontées :
- L’effet revenu : quand les salaires montent, on peut se permettre de travailler moins.
- L’effet de substitution : à mesure que le salaire progresse, les loisirs deviennent plus « chers » en opportunité. On travaille donc davantage.
C’est le deuxième effet qui l’a emporté. Les gains de productivité ont nourri la consommation : voiture, électroménager, voyages, téléphonie, confort domestique. Les standards de vie ont tellement augmenté que, pour vivre « bien », il faut maintenir un revenu plein. Autrement dit : la productivité a enrichi nos foyers, pas notre temps libre.
Le travail comme identité sociale
Travailler, ce n’est plus seulement gagner sa vie. C’est aussi exister socialement. Keynes avait sous-estimé cette dimension psychologique.
Nos métiers définissent une part de notre statut. Dire « je suis ingénieur » ou « je suis infirmière » structure notre identité. Cette fierté du rôle professionnel est profonde, mais elle nourrit aussi une dépendance : se sentir utile devient vital. C’est ce qui explique l’étonnant paradoxe révélé par l’anthropologue David Graeber (*Bullshit Jobs*) : 37 % des Britanniques estiment que leur travail n’a pas de sens. Dans la finance, la vente, ou le marketing, cette proportion dépasse les 50 %. Aux Pays‑Bas, elle atteint 40 % (Source : Graeber, 2018).
Et pourtant, peu quittent leur poste. Non par peur du vide, mais parce qu’un emploi, même absurde, structure encore la vie sociale : collègues, horaires, reconnaissance, routines. Certains chercheurs rappellent que ce sentiment reste subjectif. Ce n’est pas toujours le métier qui perd son sens ; c’est souvent la culture d’entreprise qui étouffe celui qui l’exerce.
Le théâtre de la productivité
Un autre phénomène trouble l’équation : le « ghost working ». Selon une étude (Source : Microsoft, 2023), 58 % des Américains admettent faire semblant de travailler. À l’échelle mondiale, 65 % déclarent pratiquer le « théâtre de la productivité ». Un comportement où la présence – réelle ou numérique – remplace la performance.
Ce simulacre découle d’une faille managériale : on mesure mal la productivité réelle, surtout dans les fonctions collaboratives. L’ancien adage de Cyril Northcote Parkinson garde sa pertinence : « le travail s’étend pour occuper le temps disponible ». Dans les faits, beaucoup d’équipes travaillent pour remplir les agendas, pas pour atteindre des résultats.
Autre moteur de cette théâtralisation : la peur de passer pour inactif. Dans la plupart des organisations, rester connecté, répondre vite ou afficher un emploi du temps plein reste perçu comme une preuve d’engagement. Ce réflexe se nourrit d’une culture héritée de l’ère industrielle : la valeur du travail se mesure encore en heures, non en impact.
Vers une semaine de quatre jours ?
Dans ce décor, une idée fait son chemin : réduire le temps de travail sans réduire le salaire. Le modèle 100‑80‑100 – 100 % du salaire, 80 % du temps, 100 % de productivité – a déjà été testé dans plusieurs pays. L’expérimentation britannique, menée sur 61 entreprises et 2 900 salariés, a livré des résultats frappants (Source : 4 Day Week Global, 2023) :
- Productivité stable ou en hausse
- Baisse du stress et des congés maladie
- Réduction du turnover
- Résultats financiers identiques ou supérieurs
- 92 % des entreprises ont pérennisé la mesure
Ces chiffres traduisent un potentiel réel. Réduire le temps de travail ne rime pas avec perte de compétitivité. C’est une question d’organisation et de confiance. Dans la majorité des cas, la concentration augmente, les réunions inutiles disparaissent, et la récupération mentale renforce la créativité.
Mais il faut nuancer. Les secteurs industriels, hospitaliers ou éducatifs se prêtent moins facilement à ce modèle. Les essais réussissent surtout dans les services, là où l’autonomie est forte et la production peu linéaire. D’autres alertent sur un risque d’inégalités : cadres et « cols blancs » profiteront de cette flexibilité plus facilement que les salariés d’exécution.
Changer sans fracture
Les résistances ne manquent pas : inertie managériale, croyance que le travail forge la valeur personnelle, peur de dérégler l’économie. Mais l’histoire montre que les réductions du temps de travail ont toujours suscité les mêmes craintes : le passage à cinq jours, puis à 40 heures, avait les mêmes opposants. Au final, ces réformes ont profité à tous.
Regardons vers le Nord. Le Danemark ou la Norvège enregistrent des durées hebdomadaires de travail plus faibles (entre 34 et 36 heures) tout en affichant un des PIB par habitant parmi les plus élevés du monde (Source : OCDE, 2023). Cela prouve que la prospérité ne dépend plus seulement du volume d’heures, mais de la qualité de leur usage.
Ce que cela change pour nous
Que vous soyez DRH ou salarié, cette réflexion pose une question simple : comment libérer du temps utile ?
- Réévaluer les tâches : réduire les allers-retours inutiles, les réunions redondantes.
- Mesurer l’impact : privilégier les résultats concrets aux heures déclarées.
- Recréer du sens : clarifier à quoi sert chaque poste, chaque mission.
- Oser tester : initier des pilotes à 4 jours, mesurer les effets réels sur un trimestre.
La technologie et, demain, l’intelligence artificielle peuvent amplifier ces gains. Les algorithmes délivrent déjà des gains de 15 à 25 % d’efficacité dans de nombreuses fonctions support (Source : McKinsey, 2024). En théorie, ces progrès pourraient se convertir en temps libre. En pratique, ils génèrent souvent… plus de travail. La frontière entre progrès et suractivité dépend de nos choix collectifs.
Conclusion : le vrai luxe, c’est le temps
Keynes s’est trompé sur la rapidité du changement, pas sur son sens. Nous avons atteint l’abondance matérielle qu’il prévoyait, mais pas la liberté temporelle qu’il espérait. Le défi des prochaines années ne sera pas de produire plus, mais de travailler mieux.
Il ne s’agit plus seulement de compter nos heures, mais d’en faire des heures qui comptent. Et si la prochaine révolution du travail consistait tout simplement à redonner au temps sa vraie valeur ?
Source : John Maynard Keynes, Economic Possibilities for our Grandchildren (1930) ; BBC ; OCDE ; 4 Day Week Global ; McKinsey ; Graeber (2018).
En savoir plus sur Tixup.com
Subscribe to get the latest posts sent to your email.