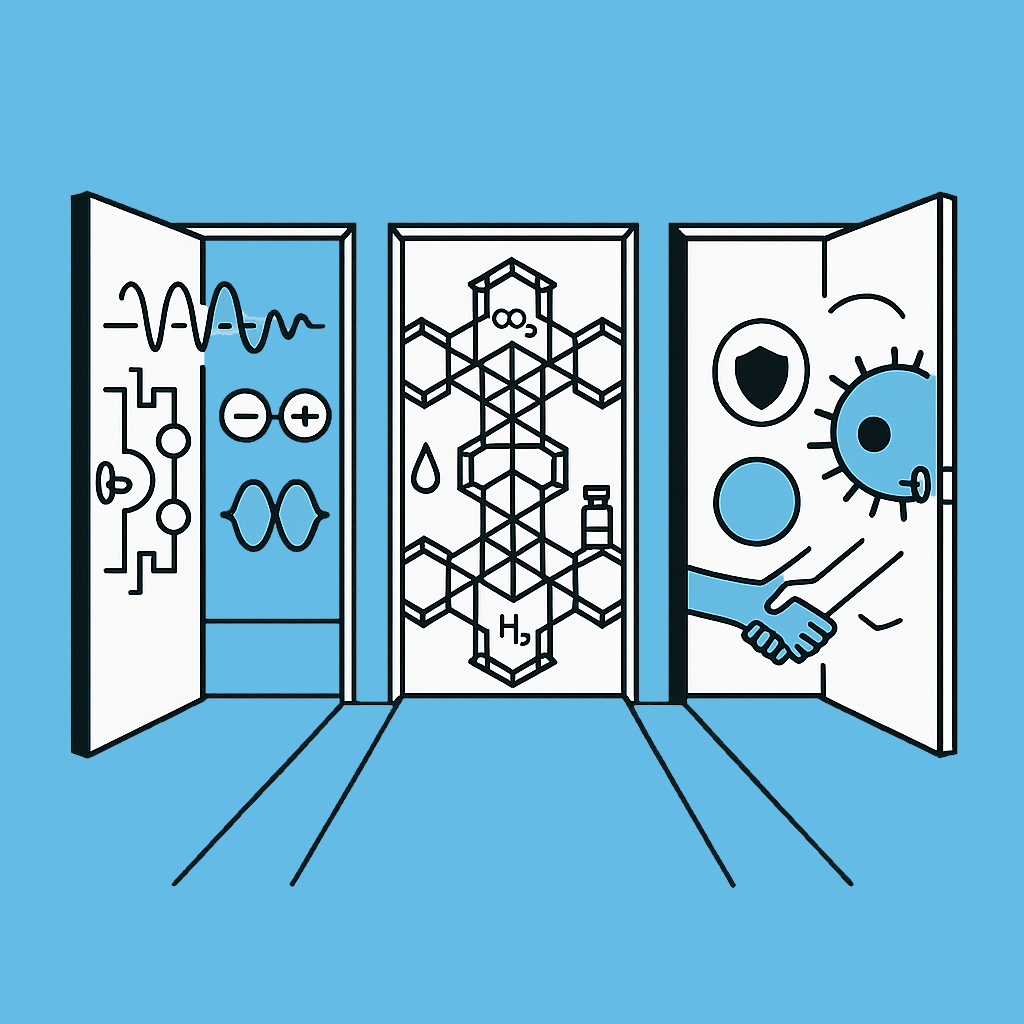Un chiffre d’abord. Plus de 70 records historiques pour le marché boursier américain certaines années, alors que les salaires, eux, stagnent. Ce contraste résume un paradoxe vieux de quarante ans : la finance avance à grande vitesse, mais la vie réelle semble à l’arrêt.
Quand les courbes divergent
Depuis les années 1980, le S&P 500 et le Dow Jones volent de sommet en sommet. Pendant ce temps, le revenu médian américain reste au niveau des années 1990, ajusté à l’inflation (Source : US Census Bureau). Le patrimoine des ménages moyens n’a pas retrouvé celui d’avant la Grande Récession de 2008. Autrement dit, les marchés battent des records, pas les foyers.
Le marché boursier fonctionne, à la base, comme un lieu d’échange — des parts d’entreprises contre du capital. Mais le sens de cette mécanique s’est transformé. Jadis, il servait à financer la croissance réelle ; désormais, il sert souvent à valoriser les actifs existants. C’est toute la nuance.
Des entreprises qui voyaient large
Après 1945, l’actionnariat public a porté la croissance. General Motors, Du Pont, IBM : ces géants créaient de l’emploi, inondaient le monde d’innovations, et payaient correctement leurs équipes. Les dirigeants se voyaient comme des responsables collectifs : ils défendaient à la fois les salariés, les clients et les actionnaires. Un équilibre fragile, mais réel.
Puis, les années 1970 ont tout changé. L’économiste Milton Friedman a résumé le tournant : « La seule responsabilité d’une entreprise est d’accroître son profit » (Source : New York Times, 1970). Une phrase, et un modèle s’écroule.
Le règne du profit court terme
Le concept de shareholder value s’impose. Les PDG reçoivent désormais des primes liées au cours des actions. Résultat : leur rémunération passe de 22 fois celle d’un travailleur moyen en 1973 à 271 fois en 2016 (Source : Economic Policy Institute).
- De 2007 à 2016, les grandes entreprises américaines ont consacré plus de la moitié de leurs bénéfices au rachat de leurs propres actions.
- Près de 39 % sont partis en dividendes.
- Moins de 10 % ont financé salaires ou investissements productifs.
Ce choix détruit de la valeur réelle. L’exemple de Wausau Paper est parlant : un fonds spéculatif, focalisé sur les dividendes, a poussé à la fermeture d’usines et supprimé 450 emplois. Le profit immédiat, oui ; la prospérité durable, non.
Quand les émotions dictent la valeur
Les marchés réagissent rarement à des faits tangibles. John Maynard Keynes parlait déjà d’un concours de beauté : les investisseurs ne choisissent pas les entreprises les plus solides mais celles qu’ils pensent que les autres trouveront séduisantes. Ce jeu de miroirs nourrit les bulles.
Souvenons-nous de la bulle Internet : à la fin des années 1990, le NASDAQ grimpe jusqu’à 5 000 points avant le fameux « dot com crash ». Trois cent mille emplois technologiques disparaissent, des retraites s’évaporent (Source : Bureau of Labor Statistics). La spéculation ne crée pas toujours de la richesse ; elle peut en détruire.
Un écart qui façonne la société
En 2020, moins d’un Américain sur deux détient des actions (Source : Gallup). La moitié des ménages reste en marge des hausses spectaculaires du marché. Pourtant, quand tout va mal, tout le monde paie : les plans sociaux, les pertes d’épargne, la récession. La bourse amplifie l’écart entre détenteurs d’actifs et salariés.
On pourrait croire à une histoire américaine. En réalité, le phénomène est mondial : le DAX allemand, le FTSE 100 britannique ou encore le Nikkei japonais ont connu la même déconnexion. Les marchés reflètent désormais davantage les perceptions que la production réelle de valeur.
La bourse : outil, pas temple
Pourtant, le marché boursier reste un formidable levier de financement. Grâce à une IPO, une entreprise peut lever des capitaux pour innover, recruter, se transformer. Le problème n’est pas la bourse, mais l’usage que nous en faisons.
Prenons l’exemple des fonds indiciels à faible coût (ETF). Ils permettent d’investir collectivement dans des centaines d’entreprises sans nourrir la spéculation excessive d’un titre unique. Ce modèle réoriente la finance vers le long terme. Là où l’on vise le court délai, l’institutionnel, lui, construit dans le temps.
De nouveaux équilibres possibles
Nous devons redonner du sens à l’investissement. Certains acteurs y parviennent déjà :
- Les fonds à impact financent les entreprises à mission et les innovations vertes.
- Les fonds de pension responsables privilégient la gouvernance et la transparence.
- Les start‑ups régionales lèvent directement des capitaux sur des plateformes locales, rapprochant épargne et économie réelle.
Ces initiatives restent minoritaires, mais elles montrent une voie : celle d’un capitalisme patient, capable de mesurer autre chose que la valorisation boursière du trimestre.
Ce que cela change pour nous
Pour un investisseur particulier, cette lecture invite à trois réflexes :
- Regarder au‑delà du titre : comprendre le modèle économique, les salariés, la vision avant le graphique.
- Privilégier le long terme : le temps est votre allié quand les marchés exagèrent.
- Diviser et lisser : investir régulièrement, sur plusieurs secteurs, via des fonds diversifiés.
Le rendement n’est pas qu’une ligne de pourcentage ; c’est aussi la contribution réelle à la société. Un placement cohérent avec ses valeurs protège autant qu’il fait croître le capital.
Une place pour la responsabilité
Les marchés ne mesurent pas la richesse réelle ; ils évaluent des attentes. Si nous, investisseurs, préférons les projets durables et les entreprises responsables, cette attente se traduira en prix, en flux, en décisions de dirigeants.
Au fond, la bourse sert de miroir collectif. Ce qu’elle reflète dépend de nous. Cherchons‑nous à spéculer sur la prochaine flambée ? Ou à orienter les capitaux vers ceux qui construisent l’économie de demain ? C’est là tout l’enjeu.
À retenir :
- La bourse peut amplifier la prospérité ou la précarité.
- L’économie réelle souffre quand la spéculation prend le pas sur l’investissement productif.
- Des solutions existent : fonds indiciels, partage de la valeur, approche à impact.
Le marché n’est pas un adversaire. Il reflète ce que nous valorisons. Si nous exigeons de la responsabilité, il la cotera. Et si nous choisissons le long terme, il le récompensera. C’est toute la puissance – et la responsabilité – de l’épargnant moderne.
En savoir plus sur Tixup.com
Subscribe to get the latest posts sent to your email.