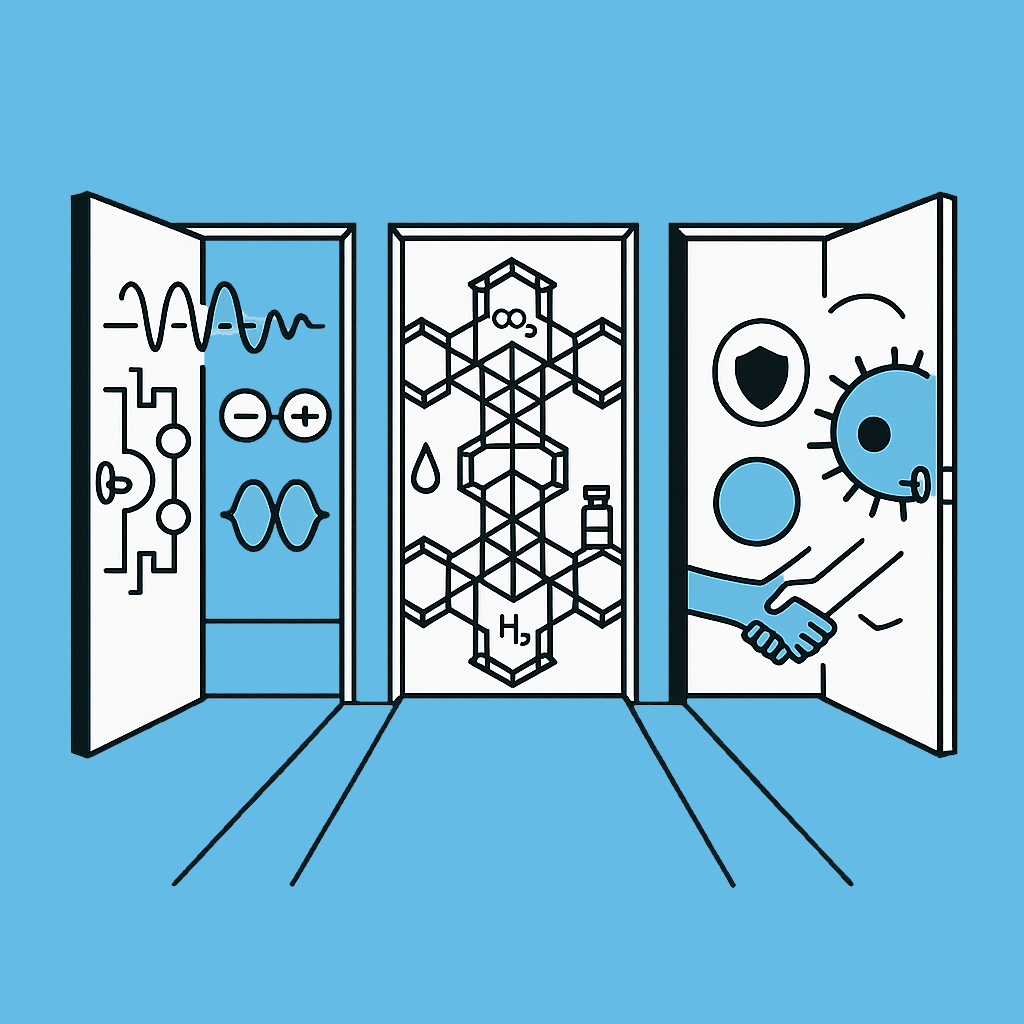Chaque année, les pays développés dépensent des centaines de milliards de dollars pour soutenir la croissance des économies en difficulté. Pourtant, 692 millions de personnes vivent encore sous le seuil de pauvreté internationale (source : Banque mondiale).
La question n’est plus de savoir si cette aide est nécessaire, mais si elle est efficace. Et surtout, si nous pouvons encore justifier un tel niveau de dépenses publiques alors que nos propres budgets s’étouffent.
Un paradoxe qui interroge nos choix budgétaires
Regardons les faits. Depuis les années 1960, l’Afrique subsaharienne a reçu plus d’un trillion de dollars d’aide extérieure. Résultat : une croissance irrégulière et peu de développement structurel durable (source : Banque mondiale). À l’inverse, la Chine ou l’Indonésie, beaucoup moins soutenues, ont connu une réduction spectaculaire de la pauvreté. Pourquoi ? Parce qu’elles ont bâti leur propre trajectoire d’investissement et de gouvernance, sans dépendre de subventions extérieures.
En économie, on parle du piège du bas revenu : l’idée que les pays pauvres restent pauvres faute d’épargne et d’investissement suffisants. L’aide devait briser ce cercle vicieux. Dans la réalité, de nombreuses études montrent un impact positif lorsqu’elle cible l’agriculture, la santé ou l’éducation (Ethiopie, Rwanda, Vietnam), mais un effet quasi nul sur la croissance à long terme (source : revue économétrique 2010 sur 100 études).
Une efficacité bridée par des causes structurelles
Ce n’est pas seulement une question de montant. C’est une question de conception et d’exécution. Lorsque les dons remplacent la production locale, ils désorganisent les filières nationales. Exemple concret : les vêtements de seconde main envoyés d’Europe ont déstabilisé toute l’industrie textile africaine (source : Economic Journal). Des milliers d’emplois locaux ont disparu. Résultat : une dépendance accrue plutôt qu’une autonomie économique.
Autre effet pervers : les grands contrats d’infrastructure menés par des entreprises étrangères laissent peu de compétences sur place. Le transfert technologique reste marginal. Et lorsque ces projets s’accompagnent d’emprunts, les États s’enlisent dans une spirale d’endettement. Aujourd’hui, plus de 60 % des pays africains consacrent davantage de ressources au remboursement de la dette qu’à la santé (source : Banque mondiale).
Un système d’aide déconnecté du terrain
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. En 2024, seulement 12 % des fonds de l’USAID atteignent directement les organisations locales. 14 % touchent les acteurs de terrain (source : Centre for Global Development). Le reste ? Il alimente une galaxie de sous-traitants américains, consultants et rapports d’audit. C’est ce que certains chercheurs ont baptisé la phantom aid : une aide fantôme qui nourrit la bureaucratie plus que le changement réel.
En 2019, 98 % des contrats attribués par l’USAID ne dépendaient d’aucun critère de performance. Presque la moitié des projets ont échoué à atteindre leurs résultats. Là encore, nous retrouvons un classique de la théorie économique : le problème principal–agent. Le bailleur (le principal) veut un impact ; l’exécutant (l’agent) cherche surtout à sécuriser ses contrats. L’objectif se dilue.
Réorienter plutôt que prolonger l’inefficacité
Faut-il tout couper pour autant ? Pas tout. Certaines expérimentations montrent des résultats rapides : les transferts sociaux en espèces, conditionnels ou non, comme Bolsa Família au Brésil ou Oportunidades au Mexique. Ces dispositifs ont réduit la pauvreté à court terme. Mais faute d’un effet durable sur la croissance, ils ne renforcent pas la base fiscale ni les institutions.
Un autre angle mérite réflexion. La corruption n’explique pas tout. Selon la Banque mondiale (2020), elle absorbe environ 7,5 % des fonds d’aide. Mais la plupart des pertes viennent du manque d’ancrage local et du faible pouvoir décisionnel des acteurs nationaux. Autrement dit, ce ne sont pas seulement les circuits de financement qui posent problème, mais la logique même de dépendance qu’ils alimentent.
Redonner la main aux pays bénéficiaires
Pour qu’une aide soit utile, il faut trois ingrédients simples :
- Un ancrage local fort : les décisions et la mise en œuvre doivent venir des communautés elles-mêmes ;
- Des contrats à résultats mesurables : l’aide ne doit être libérée que si les objectifs sont atteints ;
- Un renforcement institutionnel : fiscalité, gouvernance, cadre juridique.
Les coupes budgétaires récentes – jusqu’à 90 % pour certaines agences américaines, et de fortes réorientations européennes vers la défense – inquiètent les ONG. Elles redoutent des crises sanitaires et sociales dans les pays dépendants. Mais il est temps de reconnaître cette contraction comme une opportunité : celle de forcer la transition vers la souveraineté budgétaire et fiscale.
Moins de subventions étrangères, c’est certes moins de liquidités à court terme. Mais c’est aussi la chance de repenser la responsabilité économique et la légitimité politique à l’intérieur des pays bénéficiaires. Sans aide, un gouvernement doit mobiliser son impôt, investir dans sa propre agriculture, rendre des comptes à ses citoyens. C’est la base du contrat social.
Une réforme qui nous concerne directement
Réduire nos dépenses publiques étrangères ne signifie pas nous replier sur nous-mêmes. Cela veut dire cibler mieux. Chaque euro dépensé à l’extérieur doit produire un effet durable : autonomisation, innovation, institution. Pas un rapport de 200 pages rempli de graphiques.
Pour nous, contribuables, la question est simple : voulons-nous continuer à dépenser des milliards en subventions dont 80 % restent dans les pays donateurs ? Ou préférons-nous investir dans les leviers de résilience économique, aussi bien chez eux que chez nous ?
En résumé
- Près de 1 000 milliards de dollars d’aide depuis 60 ans n’ont pas généré de croissance durable.
- Seulement 12 % des aides américaines atteignent les acteurs locaux.
- L’endettement des pays aidés dépasse parfois leurs dépenses de santé.
- Les aides mal calibrées détruisent des filières productives locales.
- Les pays doivent renforcer leur fiscalité et leur gouvernance pour sortir du piège.
Moins d’aide ne veut pas dire moins de solidarité. Cela veut dire plus d’efficacité. Plus de réalisme. Et plus de respect pour la capacité des peuples à construire leur propre avenir. Réduire nos dépenses publiques étrangères n’est pas un retrait du monde ; c’est une invitation à le rendre plus responsable.
Source : Banque mondiale, Centre for Global Development, Economic Journal, USAID Reports 2019–2024, African Youth Survey 2024.
En savoir plus sur Tixup.com
Subscribe to get the latest posts sent to your email.