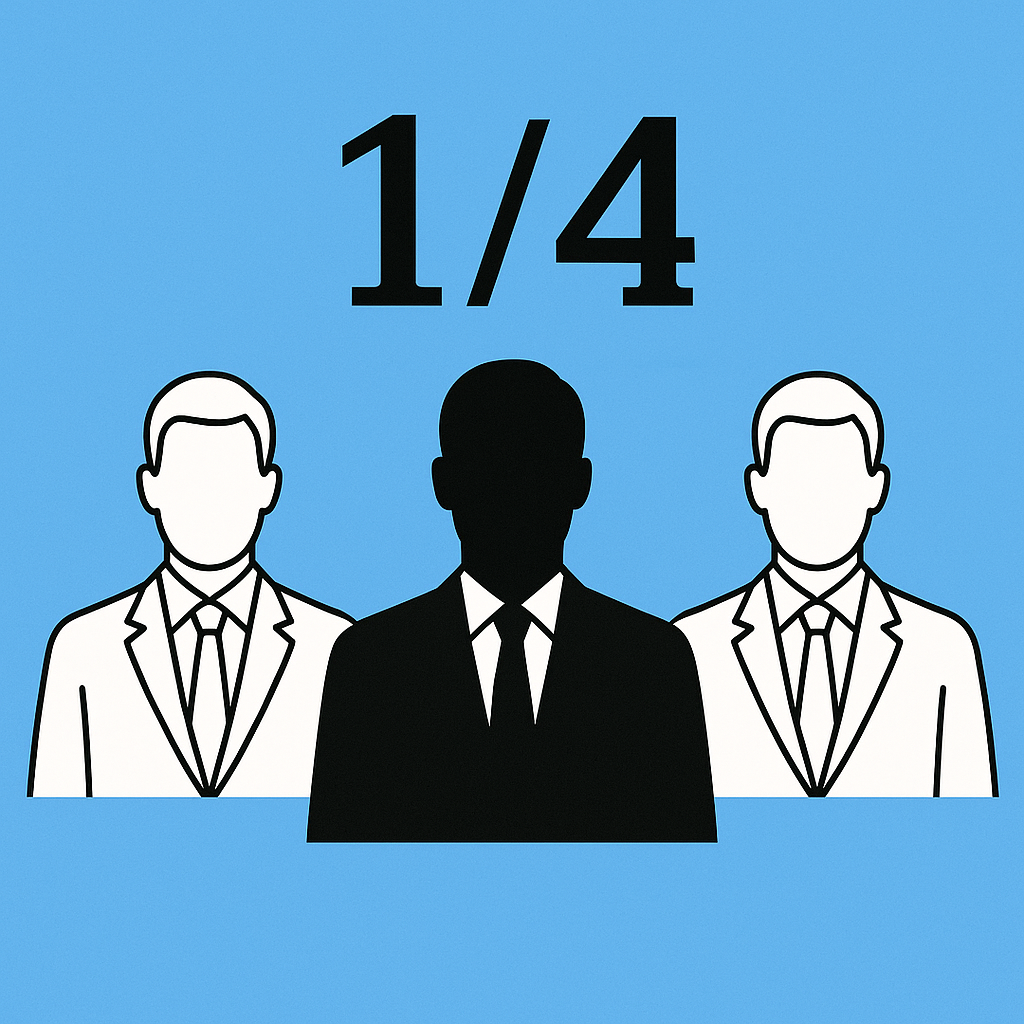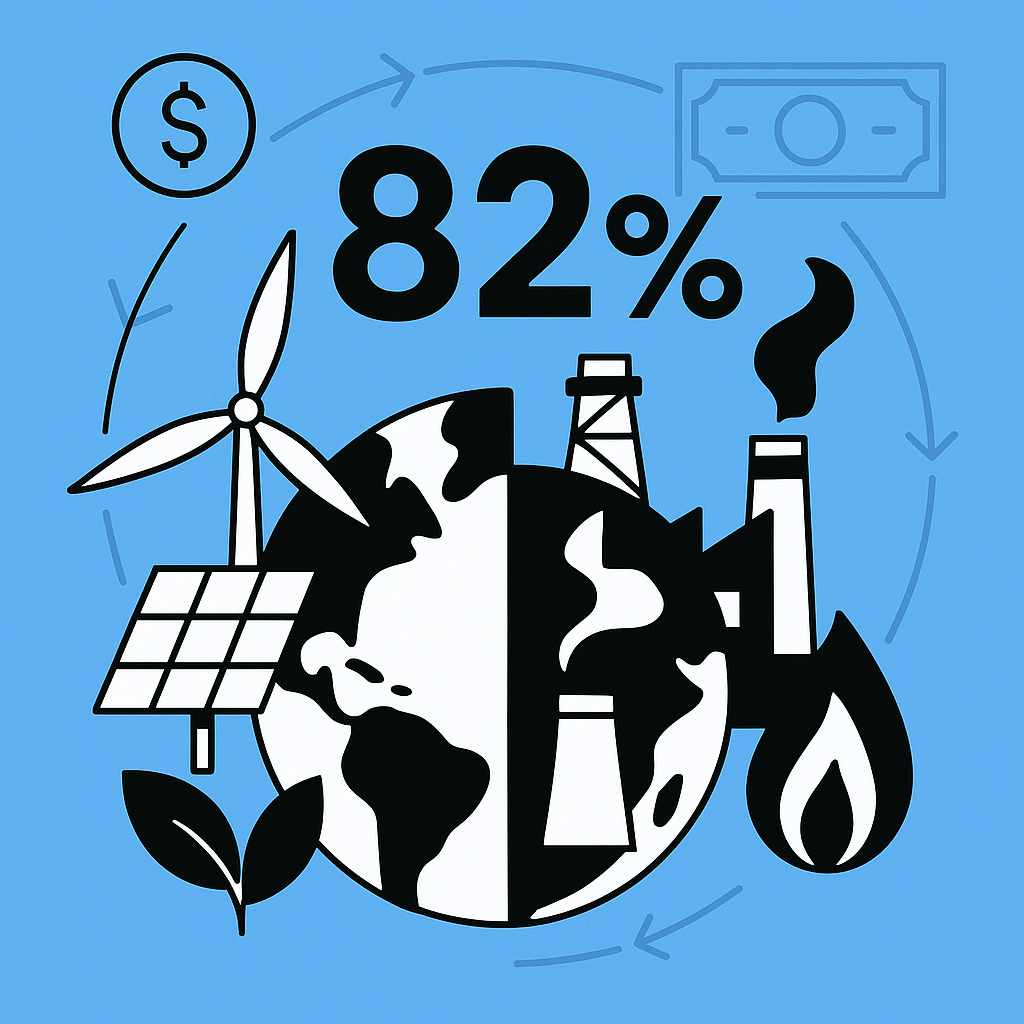Un client entre dans sa succursale pour discuter retraite. Il repart avec un nouveau fonds maison, sans trop comprendre les frais. Ce scénario, banal, illustre une réalité documentée : dans les grandes banques canadiennes, la vente prime souvent sur le conseil.
Une enquête qui secoue la confiance
Le journaliste et gestionnaire Ben Felix (PWL Capital) s’est appuyé sur des sources solides : CBC (mars 2024), Commission des valeurs mobilières de l’Ontario et Organisation canadienne de réglementation des investissements. Son constat convergent : le système place les intérêts commerciaux avant ceux des épargnants. Une culture du chiffre, pas celle du conseil.
L’étude OSC/CIRO (2 863 réponses, couvrant TD, RBC, BMO, Scotiabank et CIBC) dresse un portrait sans fard du conseiller de succursale :
- 6 ans d’expérience en moyenne,
- une certification de base,
- 10 % de la rémunération variable,
- seuls 9 % dotés d’une certification avancée (CFP, CFA).
La donnée frappe : 68 % ressentent une pression de vente au moins occasionnelle, dont 35 % souvent ou toujours. Près d’un sur deux craint de perdre son poste s’il ne remplit pas ses quotas. Quand on parle d’argent des clients, ce climat laisse peu de place à la sérénité.
Des tensions au détriment du client
Un tiers des conseillers reconnaissent que leur mode de rémunération favorise la quantité de ventes. 34 % estiment que cette mécanique peut pousser à recommander des produits inadaptés. Ce n’est pas un jugement moral ; c’est une mécanique d’incitation.
Dans un tel contexte, 25 % avouent avoir déjà vu des produits non pertinents proposés à des clients. Plus inquiétant : parmi ceux qui ont signalé un problème, 43 % disent que leur alerte a été ignorée.
La conclusion est claire : la culture de vente ne résulte pas de quelques brebis galeuses. Elle est systémique et institutionnalisée.
Des choix de produits limités
Autre contrainte méconnue : les conseillers ne peuvent souvent proposer que des produits maison. Résultat ? Moins de diversification, plus de frais. 78 % des répondants affirment que la gamme interne suffit… mais la moitié reconnaît qu’un accès à des fonds externes serait bénéfique aux clients. Ce contraste en dit long.
Ces produits internes sont fréquemment actifs, donc plus coûteux. Et quand on ajoute une formation parfois limitée, le risque d’erreur augmente. 23 % des conseillers ne savent pas définir correctement le ratio de frais (MER). Un tiers admettent que des informations inexactes sont parfois transmises aux épargnants.
Des chercheurs confirment les dérives
Les travaux universitaires cités par Ben Felix (Review of Financial Studies, 2018 ; Journal of Finance, 2021) confortent ces constats. Deux points clés se dégagent :
- Les transactions générées par les conseillers profitent davantage à la banque qu’au client.
- Les conseillers, eux-mêmes investisseurs, répètent les mêmes erreurs : trop d’activité, confiance dans la performance passée, préférence pour les fonds chers et sous-diversification.
Autrement dit : il ne s’agit pas d’une manipulation consciente, mais d’une culture d’entreprise qui perpétue des biais sans remise en question. Même après avoir quitté le secteur, les anciens conseillers reproduisent ces comportements. Le problème n’est donc pas seulement financier, il est aussi éducatif.
Le double rôle du conseiller
Ben Felix prend soin de distinguer les individus du système. Les conseillers sont, pour la plupart, sincères et désireux d’aider. Mais leur environnement les pousse vers les objectifs de vente. Un paradoxe : on leur demande d’être à la fois pédagogue et commerçant.
Il plaide pour une évolution vers plus d’exigence : certifications reconnues (CFA, CFP), standards fiduciaires renforcés, mise en avant de la responsabilité professionnelle. Autrement dit, replacer le devoir de loyauté envers le client au centre du jeu.
Vers un modèle plus sain
Chez PWL Capital, la rémunération ne dépend pas des ventes. Ce modèle rompt avec la logique traditionnelle. Les conseillers se forment en continu, sous la supervision du Center for Fiduciary Excellence. Une telle indépendance transforme la relation : la confiance remplace la pression.
Ce modèle n’est pas une utopie. Il montre qu’un conseiller peut prospérer sans vendre sous contrainte. Il s’appuie sur l’idée que la transparence et la compétence créent la loyauté du client, pas la contrainte.
Quelles leçons pour les épargnants ?
Pour nous, clients, ces conclusions changent la donne. Avant de déléguer notre épargne, il faut vérifier trois éléments essentiels :
- La formation : le conseiller détient-il une certification reconnue (CFP, CFA) ?
- La rémunération : dépend-elle des ventes ou de la performance globale ?
- Le devoir fiduciaire : existe-t-il un engagement écrit à agir dans votre intérêt exclusif ?
Un professionnel doit être évalué sur la qualité de ses recommandations, non sur le nombre de produits vendus. Ce point change tout. Il détermine le niveau de confiance que nous pouvons lui accorder.
Des pratiques à suivre
Pour mieux naviguer ce paysage, voici quelques repères simples :
- Poser des questions directes : « Comment êtes-vous rémunéré(e) ? »
- Demander la liste complète des produits accessibles.
- Comparer les fonds maison avec des ETFs indépendants.
- Lire les rapports de performance nets de frais, pas les rendements bruts.
- Faire un second avis auprès d’un conseiller indépendant.
Ces gestes basiques limitent les mauvaises surprises. Ils replacent le client dans un rôle actif. Ce n’est pas de la méfiance ; c’est de la vigilance éclairée.
Et si la réglementation évoluait ?
Le Canada pourrait s’inspirer de certains pays où le statut fiduciaire est obligatoire pour tous les professionnels du conseil en investissement. Cela signifierait : transparence des frais, certifications renforcées, absence de commissions de vente. Cette évolution n’éliminerait pas les biais, mais elle redéfinirait la relation entre banque et client.
Adopter un standard plus rigoureux, c’est protéger à la fois l’épargnant et la réputation du secteur. Dans un environnement où la confiance s’effrite, c’est aussi une opportunité de redonner du sens à ce métier : aider, pas vendre.
Conclusion : une culture à réinventer
Les chiffres parlent : un conseiller sur quatre admet des pratiques contraires à l’intérêt de son client. La moitié des employés ressentent la pression de vendre au détriment du bon sens. Ce système épuise les conseillers et fragilise la confiance des Canadiens.
Repenser la culture bancaire ne se fera pas en un jour. Mais chaque client, chaque professionnel peut commencer par une question simple : ce produit sert-il le client ou la banque ? À partir de là, le changement peut commencer, un conseil à la fois.
En savoir plus sur Tixup.com
Subscribe to get the latest posts sent to your email.