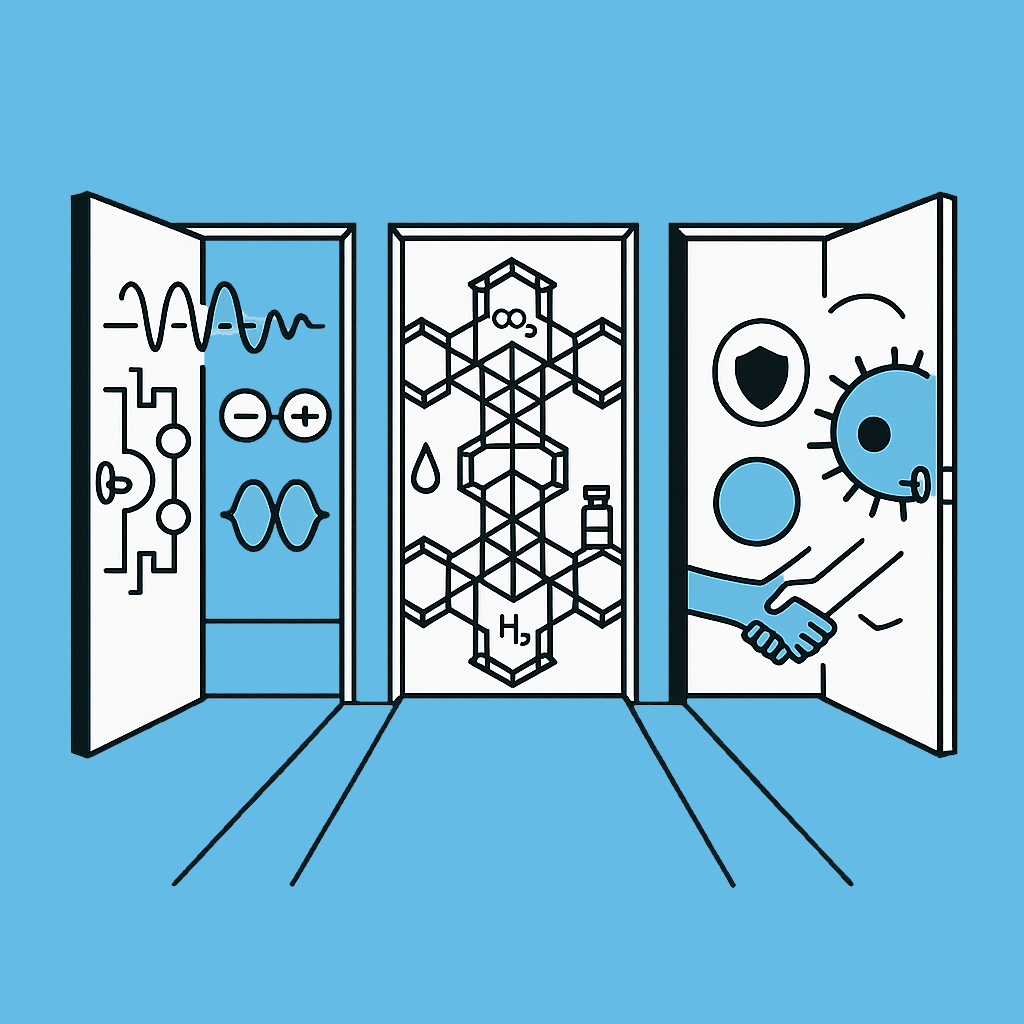Un effondrement financier, un président réformateur, une guerre qui renverse tout. De Mellon à Roosevelt, l’économie américaine entre 1921 et 1945 n’est pas qu’une succession d’événements comptables. C’est une histoire de choix politiques, de conflits idéologiques et de mutations profondes du capitalisme moderne.
1921 : La promesse du ruissellement
Imaginez une Amérique euphoriquement libérale. Les années folles débutent, les fortunes explosent. Andrew Mellon, multimillionnaire de Pittsburgh, devient secrétaire au Trésor. Il défend une idée simple : alléger les impôts des plus riches pour que la prospérité « ruisselle » vers tous. Cette théorie — la « trickle-down theory » — alimente les bénéfices des grandes entreprises (Source : Commission du Sénat sur le krach de 1929).
Mais derrière cette croissance dopée par la spéculation, les inégalités s’élargissent. Les salaires réels stagnent. Lorsque la Bourse s’effondre en 1929, l’économie s’écroule. Douze millions d’Américains se retrouvent au chômage. Le rêve de Mellon tourne au cauchemar collectif.
1932 : Roosevelt, la promesse d’un État protecteur
Au plus fort de la Grande Dépression, Franklin D. Roosevelt, gouverneur démocrate de New York, propose une rupture. Son mot d’ordre : « New Deal ». L’objectif : réguler le capitalisme et relancer l’emploi à travers l’action de l’État (Source : New York Times, 13 novembre 1932).
Des programmes de grands travaux voient le jour : la Tennessee Valley Authority (barrage et électrification), le Golden Gate Bridge, ou la National Recovery Administration qui coordonne salaires et production. Cette logique interventionniste réinvente l’économie américaine. Pour la première fois, l’État devient acteur central de la croissance.
1933-1935 : Encadrer la finance et reconnaître le travail
Entre 1933 et 1935, Roosevelt impose des règles pour stabiliser la finance. La création de la Securities and Exchange Commission (SEC) encadre Wall Street (Source : Archives du Trésor). Côté social, le Wagner Act reconnaît le droit syndical. La Sécurité sociale voit le jour. L’impôt sur les hauts revenus grimpe à 79 %. Ces mesures structurent une classe moyenne nouvelle, mais inquiètent l’oligarchie industrielle.
Pierre du Pont et Alfred Sloan (General Motors) fondent alors la Liberty League, soutenue par 36 000 chefs d’entreprise. Le message : l’État menace la liberté économique. Ce clivage entre libéraux régulationnistes et conservateurs ultralibéraux s’enracine durablement dans la vie politique américaine.
1936 : L’opinion tranche
523 grands électeurs sur 531. Voilà la victoire écrasante de Roosevelt en 1936. Le peuple soutient massivement son programme. Pourtant, les tensions sociales demeurent fortes. En 1937, à Flint, les ouvriers de General Motors se mettent en grève. Ils occupent les usines. Résultat : GM reconnaît officiellement les syndicats. L’État fédéral, pour la première fois, impose son autorité au cœur du capital industriel américain.
Ce basculement marque la fin d’un siècle de domination sans partage des grands patrons. L’économie ne leur appartient plus totalement ; elle devient un terrain de compromis fragile entre intérêts privés et politiques publiques.
1938-1940 : L’ombre du doute
La National Association of Manufacturers réagit par une contre-propagande massive. Affiches, films, discours glorifient « la méthode américaine » : libre entreprise, foi, initiative. Le but : redonner du prestige au capitalisme classique. Roosevelt conserve un large soutien populaire, mais il échoue à imposer une fiscalité réellement redistributive.
Henry Morgenthau, son secrétaire au Trésor, reconnaît l’amère réalité : « les riches ne paient pas ce qu’ils devraient » (Source : Déclarations de 1940). Les grandes fortunes utilisent les fondations caritatives comme abri fiscal. Malgré tous les efforts du New Deal, le chômage reste élevé. L’économie américaine n’a pas encore retrouvé son niveau de 1929.
1941 : La guerre, machine de relance colossale
Pearl Harbor change tout. L’économie entre en mobilisation totale. L’impôt sur le revenu devient universel : 133 millions d’Américains y contribuent, à 19 % pour les plus modestes et jusqu’à 88 % pour les plus riches (Source : Forbes, 1943). Désormais, 90 % du PIB sert la défense.
Les entreprises privées — General Motors, DuPont, Union Carbide — produisent chars, avions, navires dans des usines financées par l’État. Le plein emploi revient, les salaires progressent. Les patrons s’inquiètent : si ce modèle fonctionne, comment justifier un retour au laisser-faire ?
Ils produisent alors un nouveau narratif : celui de « l’effort privé ». Selon cette version, ce ne sont pas les politiques publiques qui ont sauvé l’économie, mais l’énergie de l’initiative individuelle. Une vision habile qui prépare le terrain idéologique de l’après-guerre.
1945 : Le jour d’après
Lorsque Roosevelt meurt en avril 1945, Harry Truman hérite d’un pays victorieux, puissant, industrialisé à un degré inédit. Mais cette puissance repose sur une alliance ambiguë : État, armée et industrie forment désormais un complexe militaro-industriel. La dépendance à l’investissement public est immense, et pourtant, beaucoup rêvent déjà d’un retour à la normalité du marché libre.
Les usines de guerre, construites avec l’argent de l’État, sont transférées au secteur privé. Les profits explosent, même si les taux marginaux d’imposition atteignent encore 91 %. En quelques années, les États-Unis produisent la moitié de la richesse mondiale. La répartition du pouvoir s’est déplacée : le capital ne dirige plus seul, mais il reconquiert ses marges d’action.
Leçons pour aujourd’hui
Regarder cette période, c’est réfléchir à ce que signifie une économie équilibrée. Trop de liberté sans régulation finit par créer des bulles et des crises. Trop d’étatisme peut étouffer l’initiative. Roosevelt l’avait compris : il ne s’agissait pas de détruire le capitalisme, mais de lui donner de nouvelles règles de jeu.
- Premier enseignement : une fiscalité juste stabilise la société autant qu’elle finance l’État.
- Deuxième enseignement : l’investissement public peut déclencher des périodes de prospérité durable (les grands travaux l’ont prouvé).
- Troisième enseignement : sans cadre social, la croissance devient inégalitaire et fragile.
Ces débats, nés dans les années 1930, traversent encore nos politiques économiques. Les plans de relance, les promesses de taxation équitable, les débats sur l’intervention de l’État : tout vient de là. Chaque crise ramène la même question : comment faire pour que la prospérité profite à tous ?
Conclusion : Quand le passé éclaire nos choix
Entre Mellon et Roosevelt, les États-Unis ont redéfini la place de l’État dans l’économie mondiale. D’un extrême à l’autre, ils ont appris par l’épreuve. Comme souvent, c’est la crise qui a imposé l’innovation. Comprendre cette séquence, c’est mesurer que derrière les chiffres, il y a toujours un choix politique. Et que l’histoire économique n’est pas un bilan, mais un miroir pour nos décisions présentes.
« L’économie n’est pas une mécanique. C’est une affaire humaine. » Ce constat, vieux d’un siècle, reste d’une actualité désarmante.
En savoir plus sur Tixup.com
Subscribe to get the latest posts sent to your email.